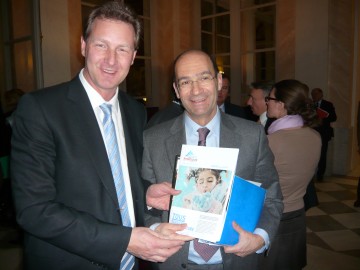Texte de mon intervention de cet après-midi à la Tribune de l'orateur :
Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Rapporteur,
Mes chers collègues,
Je crois qu'il est nécessaire, à ce stade de la discussion, de bien repréciser de quoi nous parlons. A entendre les socialistes, le texte que nous examinons assassine littéralement l'opposition, en la privant du droit de parole. Je pense que ces propos sont particulièrement excessifs, surtout à ce stade de l'application de la réforme constitutionnelle.
Nous débattons ici d'une loi organique, qui fixe un cadre, ouvre des possibilités et pose des limites à l'intérieur desquelles devra être réformé le règlement de notre assemblée. Le moment crucial, ce sera donc bien l'examen de la réforme du règlement de l'Assemblée, lorsque nous seront appelés a définir concrètement et complètement la manière dont nous souhaitons que se déroulent nos débats.
Le point central, qui fait débat, porte sur les conditions de l'exercice du droit d'amendement. Mais d'autres points semblent également vous poser problème.
Cette loi organique ouvre la possibilité de mettre en place une procédure simplifiée d'examen en séance publique, sans possibilité d'amendement parlementaire. Il existe déjà des procédures simplifiées, qui certes ne vont pas aussi loin, mais qui n'ont jamais posé, à ma connaissance, de problème.
Cette procédure simplifiée sera utilisée pour des textes techniques et sans enjeu politique, après décision en conférence des présidents.
Un autre point, serait la possibilité de limiter les débats en séance publique, par la fixation d'un temps de parole maximal et par la possibilité de faire voter certains amendements sans débats.
Tout d'abord, que savez-vous de la procédure exacte qui sera retenue ? Nous n'en sommes qu'au stade de la loi organique, qui fixe juste le cadre. Que savez-vous de la manière dont la procédure sera effectivement appliquée ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a souvent une très grande souplesse dans l'interprétation et dans l'usage qui est fait du règlement, et que l'application rigoureuse par la majorité est rare et toujours motivée par le comportement de l'opposition ! Il ne nous viendrait pas à l'idée, sans raison, d'appliquer le règlement dans toute sa rigueur !
Nous ne légiférons pas sur ce sujet pour les quelques années qui viennent, mais pour plusieurs décennies, je l'espère. D'ici là, nous nous retrouverons sans doute dans l'opposition. Nous serions stupides de mettre en place des procédures qui pourraient se retourner contre nous !
A la limite, nous n'avons pas besoin de cette procédure pour vous empêcher de faire de l'obstruction. Mais les mauvaises habitudes sont malheureusement bien ancrées. Une application beaucoup plus stricte du règlement, Monsieur le Président, et quelques modifications mineures suffiraient. On pourrait très bien décider de fusionner tous les amendements identiques, avec un orateur pour et un orateur contre, avant de passer au vote. On pourrait également limiter le nombre d'intervenants sur les débats, à propos d'amendements pouvant être mis en discussion commune. On pourrait également appliquer strictement l'article 41 de la constitution sur l'irrecevabilité règlementaire, et instaurer une procédure pour déclarer irrecevables les amendements n'ayant aucun rapport avec le texte en discussion. Rien qu'avec cela, votre capacité à retarder les débats serait bien amoindrie ! Mais force est de constater que vous n'avez jamais souhaité respecter les règles du jeu, depuis le début de cette treizième législature, sans quoi, nous n'en serions pas là.
Enfin, il est un dernier point sur lequel nous devrons rester vigilants, et je m'explique. A partir du moment où un temps de parole limité est attribué à chaque groupe, que certains amendements seront discutés en séance publique et d'autres pas, je ne souhaite pas que nous nous dirigions vers une restriction a outrance des possibilités d'initiative individuelle. Nous disposons actuellement, au sein du groupe UMP, d'une très grande liberté de prise de parole, de dépôt d'amendements et de propositions de loi sans filtrage préalable du groupe parlementaire. J'apprécie beaucoup cette manière de fonctionner et je souhaite vivement qu'elle ne soit pas remise en cause par la réforme que nous sommes en train de voter.
Mes chers collègues de l'opposition, votre position m'attriste beaucoup, car elle révèle une grande défiance vis-à-vis des députés de la majorité. Vous semblez ne pas nous faire confiance, alors que nous souhaitons une meilleure organisation de nos travaux, tout en respectant des droits de l'opposition.
Celà fait maintenant un an et demi que je suis député, et je n'ai pas l'impression que vous ayez été brimés ! Au contraire, vous avez toujours pu vous exprimer autant que vous le vouliez, même quand vous abusiez. Vous avez été constamment associés à l'organisation des travaux, votre accord a toujours été recherché lorsqu'il fallait terminer un peu plus rapidement l'examen d'un texte.
Vous voyez dans ce projet de loi organique une volonté de porter atteinte à vos droits. Il s'agit là d'un procès d'intention alors qu'il n'a jamais été question, au sein du groupe UMP, de porter atteinte aux droits de l'opposition. Vous vous trompez de combat, et au lieu d'aller de l'avant, vous continuez, comme d'habitude, à privilégier l'obstruction. C'est un choix, mais je crois sincèrement que les français attendent autre chose de leurs parlementaires.