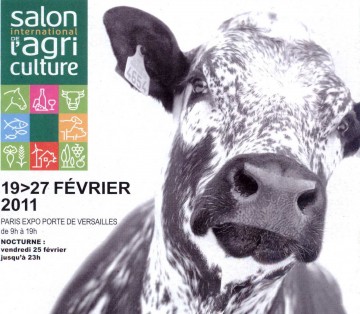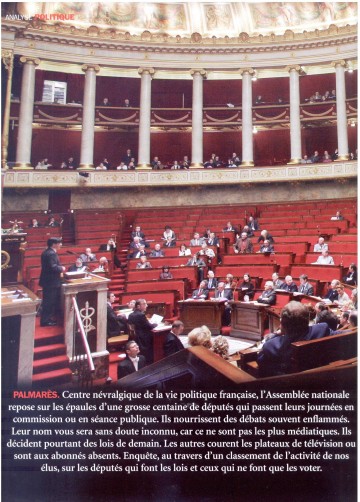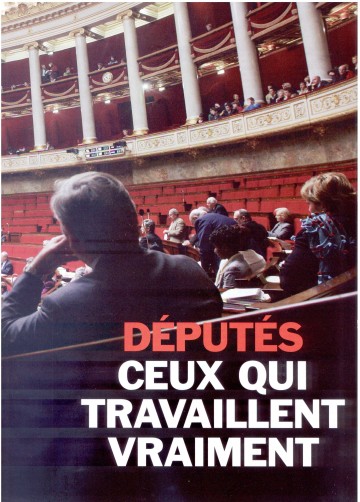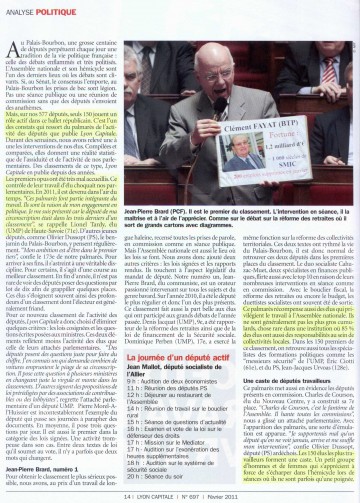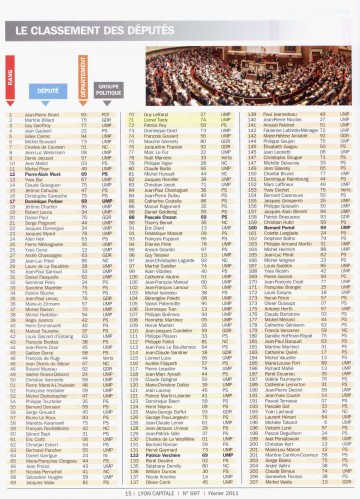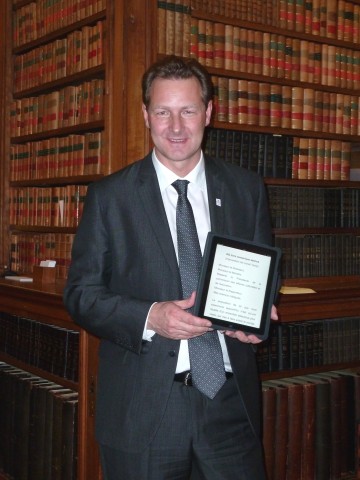La situation du logement social en 2010
Benoist APPARU a présenté le bilan en matière de construction de logement social en 2010 : 131 509 logements sociaux ont été financés, soit 9,7 % de plus qu'en 2009. Ainsi 2010 est une année record en matière de création de logements sociaux.
Au 1er janvier 2010, la France comptait 4,5 millions de logements locatifs sociaux, permettant de loger environ 10 millions d'habitants. Sur les 131 509 logements sociaux créés en 2010, 76,5 % l'ont été dans le neuf et 23,5 % dans l'ancien. A ce résultat s'ajoutent les 16 500 logements financés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre de la reconstitution de l'offre. Dans la droite ligne des engagements pris par le Gouvernement le 6 février 2010, la construction de logements s'est concentrée là où les besoins étaient les plus pressants, notamment en Ile-de-France ou en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Par ailleurs, en 2010, le nombre de logements destinés aux ménages les plus modestes a largement franchi le seuil symbolique des 20 000 logements inscrits dans la loi DALO pour atteindre un chiffre record de 26 836 prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) en 2010, en progression de plus de 25 % par rapport à 2009.
Les priorités pour le logement en 2011 :
En 2011, le Gouvernement a défini plusieurs priorités en matière de politique du logement :
-
une plus grande adaptation de la production de logements sociaux aux territoires qui en ont le plus besoin. Au total, l'effort de l'Etat pour le logement locatif social s'élèvera en 2011 à 4,5 milliards d'euros dont 500 millions d'euros d'aides directes. A cela viendront s'ajouter les 5 milliards d'euros d'aides à la personne qui seront versés aux bailleurs sociaux en tiers payant pour les 2,2 millions de locataires éligibles. Par ailleurs, dès le mois d’avril un numéro de dossier unique pour les demandeurs sera mis en place, ce qui permettra de prioriser et de mieux suivre les demandes.
-
des dispositifs d'hébergement seront développés, comme l’intermédiation locative qui consiste à louer des logements dans le parc privé à des associations qui les sous-louent. En effet, 300 logements étaient mobilisés fin 2009, 2315 fin 2010 et l’objectif est de capter 5000 logements privés d’ici la fin de l’année 2011.
-
la politique du logement ouvre plusieurs grands chantiers, comme l’urbanisme de projet destiné a simplifié l’urbanisme au service de la construction. Il s’agit de mettre en œuvre une politique d’offre dynamique et mieux répartie, en donnant les moyens nécessaires aux personnes qui veulent construire.
-
en ce qui concerne le chantier de l’accession à la propriété, la mise en place du PTZ+, lancé le 1er janvier dernier va permettre à un plus grand nombre de Français de devenir propriétaires. Le PTZ+ est universel, sans conditions de ressources et s’adressera à 380 000 bénéficiaires chaque année. Il s’inscrit dans une politique globale du logement en incitant à la construction de logements neufs là où la demande est forte et en favorisant les logements performants sur le plan énergétique. Il s’agira également de rendre plus efficace et d’élargir la diffusion l’éco-PTZ mais aussi de faire en sorte que le diagnostique de performance énergétique, qui permet aux ménages d’évaluer la consommation énergétique d’un bien et son coût, devienne un document de référence.
-
enfin, la lutte contre la précarité énergétique sera renforcée avec le programme « Habiter Mieux ». La part des dépenses d’énergie dans le logement a fortement augmentée et quelques 3,4 millions de ménages consacrent plus de 10 % de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie. Pour cela, 1,25 milliard d’euros seront mobilisé jusqu’en 2017 et, à court terme, le Gouvernement se fixe comme objectif la rénovation de 135 000 logements d’ici à 2013.